N°10 – Marc – Entendre ce qui n’a pas encore de son, voir ce qui n’a pas encore de forme
| Complet | Article |
J’ai poussé la porte du Café où ce soir-là j’étais attendu. Les yeux mi-clos, du regard j’ai scruté l’espace, à dessein de trouver une zone calme où me poser.
Rien ne différenciait des autres clients la jeune femme qui voguait de table en table, sinon le plateau dans ses mains, sur lequel tenait, en équilibre, théière et gobelets.
Du bec verseur de la porcelaine s’échappait un nuage de vapeur, qui en alternance, la rendait une fois visible, une fois invisible, faisant apparaître et disparaître les traits de son visage.
Je fus soudainement entraîné à Delft, en 1665 dans l’atelier de Joannes Vermeer au moment même où la main du maître allait donner corps au visage de son modèle à qui il avait posé une perle à l’oreille.

J’entrevoyais la serveuse dans ce lent processus, entre l’esquisse et l’oeuvre finie et j’eus l’impression que cette jeune femme m’apparaissait en train de se créer devant moi. Le visible et l’invisible se confondaient si bien qu’il me fut impossible de voir l’un sans ressentir l’autre. Elle marchait vers moi portant dans ses mains tendues son début et son devenir à la fois.
Elle était simultanément la lumière et l’obscurité, l’action et la réaction, le son et le silence, le printemps et l’hiver. Dans cette fraction de seconde, elle fut tout ça à la fois. Apparitions et disparitions, comme la chaîne des morts et des naissances, de toutes les éphémères réalités du monde.
Et dans le plus grand tumulte de la pleine tempête, lorsque l’image de la jeune femme s’est heurtée aux rochers dressés de ma réalité, lorsqu’elle a éclaté en million de particules liquides, lorsque d’embruns elle s’est transformée en vapeur, que le vent l’a emportée vers un voyage sans fin ni commencement, c’est à ce moment précis, que je fus envahi par la peur.
Cette frayeur qui frappe, lorsque soudainement confronté à un événement sur le point de survenir, apparaît le signe avant coureur; cette infime secousse qui fait trembler la terre sous nos pieds. J’ai su, comme dans un éclair fulgurant que cette fille, inconsciente, portait à fleur de peau, tout son devenir.
Il m’était donné d’entrevoir mille tableaux réunis en un seul; la sensation que toute l’oeuvre d’une vie, à peine commencée, s’étalait là devant moi.
Tout cela, sans introduction, sans transition; en images brutes comme un volcan d’où s’échappe une fumée blanche qui cache, pour l’instant encore, le visage de la montagne à venir. J’étais en route vers un nouveau monde, sur un chemin que je ne connaissais pas. C’est pourquoi j’eus peur.

Le patron du Café, celui que je devais rencontrer, est venu s’asseoir avec moi et avant de commencer à discuter, m’a demandé ce qui me ferait plaisir.
Dix minutes plus tard, la jeune femme déposa l’allongé devant moi et me demanda si j’avais l’habitude de le boire noir ou avec du lait chaud. Le timbre de sa voix, émaillé de cette innocente poésie, propre aux étrangers en apprentissage du français, a fait voler en éclats les parois de toute rationalité. Une musique que je n’avais jamais encore entendue; une symphonie majeure en decrescendo; un français parlé avec l’accent dont les Perses devaient user à Persépolis, du temps de Darius le Grand. Sortant de sa bouche, les sons étaient doux, lents et prolongés, telle une supplique ou une mélopée adressée à quelques déesses millénaires. Sa présence devant la table eut l’effet d’un lever du soleil qui allait se prolonger pendant des siècles. Le printemps venait de chasser l’hiver. L’espace entre ses mots donnait le temps aux bourgeons d’éclater et la fin de ses phrases faisait naître des fleurs.
Moi, qui toujours prends le café noir, j’ai accepté le lait chaud pour le plaisir de voir danser devant moi ses mains orientales. Je ne savais plus où j’étais et le pourquoi de ma venue. Le plateau massif de chêne sur lequel j’étais appuyé avait du mal à contenir mes soupirs. Le vide rétroactif causé par les années d’absence de cette femme eut pour effet de me faire basculer dans un étourdissement proche du vertige.
Vers la fin de l’entretien, le propriétaire du Café crut bon de me présenter à la jeune Iranienne, Maryam, une étudiante à l’école des Beaux Arts, qui pour arrondir ses fins de mois, travaillait au service de table. Déjà sympathique à mon égard, sachant que je faisais partie de la communauté artistique, son regard m’enveloppa d’un voile invisible, pendant que tous ses sens voulaient répondre aux mille questions que je ne lui avais pas encore posées.
Cette représentation orchestrée depuis des siècles, ne fut en réalité que le préambule d’une longue réflexion qui allait s’échelonner sur plusieurs années.
De retour à mon atelier, je mis de longues heures pour retrouver mon calme. Je faisais les cent pas pendant que cette phrase me revenait sans cesse à l’esprit; Elle est enfin revenue! Elle est de retour! Mais qui était-elle, celle qui était de retour, puisque je n’attendais personne ?
C’est pourquoi la peur première, progressivement se transforma en vertige.
Je ne savais rien d’elle, sinon si peu. Arrivée à Montréal depuis deux ans seulement, Maryam s’était évertuée de jour comme de nuit à l’étude du français. Pendant ces deux années, elle me le dira plus tard, elle arpentera la ville, quadrillera centimètre par centimètre le quartier où elle s’était installée, dans le but de comprendre et d’apprivoiser les nouveaux codes de son pays d’adoption. Tout lui était inconnu, étrange. Émil Cioran ne peut pas mieux dire lorsqu’il déclare: On n’habite pas un pays, on habite une langue. Et sa langue à elle, c’est le farsi. Son pays à elle c’est la langue perse.
Maryam vivait l’exil. Elle vivait en aller-retour d’une langue à l’autre, d’un territoire à l’autre, perdue, étrangère dans un monde comme dans l’autre.

Dans son livre « Nord perdu » Nancy Huston, exilée elle-même, raconte; qu’un exil peut en cacher un autre. Elle dit que;
la discontinuité géographique peut dissimuler des années durant, une discontinuité sociale et que pour ne pas faire de vagues, vous justifiez tous les malentendus entre vous et votre famille par «le choc des cultures», la difficulté d’expliquer l’une dans les termes de l’autre. Mais insensiblement, votre âme aussi et pas seulement votre corps s’est éloigné de son point de départ. Et un jour il vous faut reconnaître que vous ne partagez plus les valeurs de ceux qui vous ont engendré, ceux qui vous ont parlé, choyé, nourri dans la chaleur et la complicité de la maison familiale. Quand bien même vous ne vous seriez initié à aucun idiome étranger, vous ne parlez plus leur langue.
En tant qu’observateur, j’avais le loisir de prendre du recul, chose que Maryam ne pouvait pas faire. J’eus souvent l’impression de voir venir les choses avant elle, ce qui au début l’étonnait, mais avec le temps, il a bien fallu admettre que le formidable réseau nerveux qui relie les êtres entre eux était bel et bien une réalité et les artistes, plus que les autres, avaient cette sensibilité qui les garde en communion constante à travers le temps et l’espace. Une harmonie s’est mise en place et nous étions les spectateurs du processus de la création d’une symphonie, commencée il y a des millions d’années et qui était loin d’être achevée.
Je devins sa plume concernant les textes sur sa démarche, les résumés de lectures ou les dossiers qu’elle devait remettre à l’université. Il m’arriva de plus en plus souvent de formuler une idée pour une œuvre qu’elle s’apprêtait à mettre en chantier et qu’avant même de lui remettre le texte, elle me raconta de vive voix, le mot à mot de ma propre formulation.
Elle me racontait avec ses mots, comment elle comptait s’y prendre pour réaliser telle ou telle œuvre, et de mon côté, je traduisais dans un français correct, le processus qu’elle allait suivre.
Combien de fois n’est-elle pas revenue de ses nocturnes pérégrinations, riche de nouveaux artefacts, tel ce caillou prélevé de la masse minérale du Mont-Royal en me disant qu’elle avait entre ses mains l’âme de Montréal.
Elle me disait; «lorsque pour la première fois, j’ai posé les pieds sur le sol montréalais, la cité et moi ne parlions pas le même langage. La ville semblait se méfier de moi et réciproquement, m’a-t-elle avoué. J’étais une émigrante en terre étrangère, alors j’eus l’idée de lui parler dans sa langue afin de l’apprivoiser. Dès lors je me suis mise à réfléchir en français et à parler à la ville en français. Et pendant qu’au rythme des jours et des saisons, à bout de souffle, je déambulais dans ses artères à la recherche de mes repères, de mon identité, je commençais à faire des liens entre la cartographie intime de la ville et l’anatomie de mon propre corps. La ville vivait, elle respirait et moi je vivais en elle. Nous parlions le même langage et ensemble nous devenions complices. Nous étions bien toutes les deux.»
De deux dimensions, voilà que soudainement la ville lui dévoilait sa morphologie, sa topographie et ses labyrinthes de rues et de ruelles secrètes.
Elle sentait ce qui se cachait sous les grandes tours de verres qui se dressent au cœur de la cité, elle savait que sous ses couches de bitume et de béton; son infrastructure, les corridors de métro, les canalisations, l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone sont en résonance avec le corps humain. Et plus profond encore, les traces archéologiques du passé de la ville devaient correspondre à la mémoire de ses premiers habitants.
La vue des ponts, ces grandes structures métalliques qui enjambent les rivières, qui ont pour fonction de relier l’île au continent, devait éveiller en elle des souvenirs intimes qu’elle croyait endormis.
Son travail de plasticienne est un éternel questionnement et les réponses se formulent avec d’autant plus d’aisance qu’elle utilise la matière plutôt que les mots. Son œuvre véritable, c’est de laisser la parole à la ville.
Maryam, en symbiose avec la ville, nous donne une œuvre singulière où la lumière, les murmures de la ville et le vide sont autant de matériaux invisibles capables de nous faire ressentir l’essentiel; l’harmonie entre l’homme et son habitat.
Devant le travail de cette artiste, on ne peut que penser au mot de l’empereur Houang-Ti: Saisir les fils du devenir, avant l’être, alors qu’ils sont encore tendus sur le métier à tisser cosmique, voilà la joie céleste, qui se ressent, mais ne peut s’exprimer.
Alors plutôt que de m’émouvoir devant une œuvre d’art accrochée sur la cimaise d’un musée, j’ai préféré me laisser entraîner dans la joie d’assister à la naissance de sa créatrice.












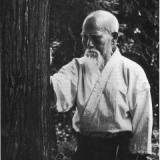




Commentaires récents